|
 |
Lexique
A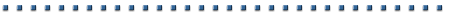
|  |  Accident vasculaire cérébral : Accident vasculaire cérébral :
Lésion du cerveau due à une hémorragie ou à l'obstruction brutale d'une artère entraîne malaise, paralysie, coma.
 Acétone : Acétone :
L'acétone est une substance fabriquée normalement par l'organisme à partir des lipides (corps gras). Elle augmente dans le corps lorsque les cellules sont en hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop bas) ou encore quand le sucre ne peut pénétrer convenablement dans les cellules. Ceci survient quand l'insuline est inefficace ou quand son taux est insuffisant dans le sang (hypoinsulinémie). Ceci se rencontre dans certains diabètes entre autres. L'excès d'acétone dans l'organisme est mis en évidence grâce aux analyses d'urines (acétonurie) où elle est détectée en utilisant un test simple avec des bandelettes réactives.  Acétonémie : Acétonémie :
Présence d'acétone dans le sang. L'acétonémie désigne également la présence d'autres corps cétoniques dans le sang. On parle de vomissements acétonémiques.
 Acétonurie Acétonurie
Présence d'acétone dans les urines, notamment chez les personnes atteintes de diabète.  Acidocétose : Acidocétose :
Variété d'acidose observée parfois dans le diabète, qui s'accompagne de vomissements, de troubles digestifs ou hépatiques. Elle est dûe à l'accumulation des corps cétoniques en quantité importante qui s'éliminent par l'urine. En général elle est la conséquence d'une carence en insuline d'ou l'hyperglycémie très sévère. Lorsque que les mécanismes régulateurs sont dépassés et en l'absence de correction par un apport d'insuline assez important et une hydratation efficace, elle peut évoluer vers un pré-coma ou un coma.  Adrénaline : Adrénaline :
Hormone sécrétée par la glande médullo-surrénale (voir surrénale), dont l'action physiologique est comparable à l'excitation du système nerveux orthosympathique
son effet : accélération du coeur, augmentation de la force des battements, contraction de certains vaisseaux, dilatation des coronaires, dilatation de la pupille, relâchement de certaines fibres musculaires
 Adrénergique : Adrénergique :
Qui agit par libération d'adrénaline.  Albumine : Albumine :
Principale protéine du sang, soluble dans l'eau et fabriquée par le foie.  Albuminurie : Albuminurie :
Le terme protéinurie désigne la présence de protéines, de n'importe quelle nature, dans les urines. L'albuminurie correspond, plus spécifiquement, à la présence dans les urines, d'une variété particulière de protéine : l'albumine.
 ALFEDIAM : ALFEDIAM :
Association de Langue Française pour l'Etude du Diabète et des Maladies Métaboliques.  Algique : Algique :
Qui est en rapport avec la douleur.  Allotransplantation : Allotransplantation :
Greffe pratiquée entre deux individus appartenant à la même espèce animale, mais génétiquement différente. L'avantage principal de l'autogreffe est l'absence de phénomène de rejet.  Amyotrophie : Amyotrophie :
Diminution de volume des muscles. Cette fonte musculaire ne concerne que les muscles striés c'est-à-dire les muscles sous la dépendance de la volonté.  Amputation : Amputation :
Ablation d'un membre ou d'un segment de membre par opération chirurgicale ou non, par un accident ou de façon non traumatique.  ANAES : ANAES :
Acronyme (sigle) de Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé. Il s'agit d'un établissement appartenant à l'administration publique. L'ANAES (précédemment ANDEM) a pour but de « favoriser le développement de l'évaluation médicale dans l'ensemble du système de santé et de mettre en place la procédure d'accréditation dans les établissements de santé ».  Analogue insuline : Analogue insuline :
Les analogues d´insuline sont des versions de l'insuline humaine qui contrôlent plus strictement le taux de glucose dans le sang que l'insuline humaine normale, en raison de leur capacité à imiter plus étroitement les modèles physiologiques de sécrétion de l'insuline d'un corps normal.  Analogue rapide : Analogue rapide :
Les insulines rapides agissent rapidement et pendant seulement quelques heures.
 Angéiologue : Angéiologue :
Spécialiste médicale des vaisseaux sanguins.  Angine de poitrine : Angine de poitrine :
Douleur oppressante, liée à une obstruction partielle des artères coronaires, et qui peut se manifester dans la poitrine, le bras gauche, la mâchoire.  Angioplastie : Angioplastie :
Intervention chirurgicale utilisée pour réparer la déformation de vaisseaux ou pour dilater voire remodeler un vaisseau rétréci.  Anticorps Anticorps
Substance spécifique et défensive, de nature protéique, engendrée dans l'organisme par l'introduction d'un antigène, avec lequel elle se combine pour en neutraliser l'effet toxique.  Antigène : Antigène :
Substance qui peut engendrer des anticorps.  Antiseptique : Antiseptique :
Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.  Artère coronaire : Artère coronaire :
Artère irriguant le myocarde.
Le rétrécissement des coronaires provoque l'angine de poitrine, voire l'infarctus du myocarde.
 Artériographie : Artériographie :
Examen radiologique des artères.  Artériopathie : Artériopathie :
Terme désignant une pathologie concernant une artère, indépendamment de sa cause.  Artériopathie des membres inférieurs : Artériopathie des membres inférieurs :
Pathologie due à une atteinte artérielle touchant les membres inférieurs et aboutissant à une diminution voire à un arrêt de la circulation dans les artères concernées. Il s'agit du résultat de l'athérosclérose entre autres. Il existe d'autres facteurs de risque dans la survenue de cette pathologie : le tabac, le diabète (élévation du taux de sucre dans le sang), l'hypertension artérielle, les troubles lipidiques (augmentation des graisses dans le sang), l'obésité.  Astreinte médicale : Astreinte médicale :
Disponibilité médicale 24h/24h par appel téléphonique en cas de problème médical dûe à la pompe à insuline.  Athérosclérose : Athérosclérose :
Vieillissement et rétrécissement des artères, dus à des dépôts de cholestérol et de calcium.  Atrophie : Atrophie :
Défaut de nutririon d'un organe ou d'un tissu, qui se manifeste par une diminution de son poids ou de son volume.  Auto-immune : Auto-immune :
Se dit de maladies où l'organisme produit des anticorps nuisibles à ses propres tissus.  Autosurveillance : Autosurveillance :
Le diabétique ne ressent que rarement les effets d’une hypo ou d’une hyperglycémie, à moins d’être dans des valeurs extrêmes.
C’est pourquoi il est primordial, quelque soit le diabète dont vous souffrez, de contrôler votre glycémie régulièrement.
Votre médecin vous indiquera les moments privilégiés pour contrôler votre glycémie. Il peut aussi être nécessaire de la contrôler dans des situations particulières susceptibles de faire varier votre taux de sucre sanguin comme en cas d’activité sportive, de repas de fête, etc.. |
C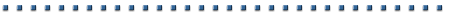
|  |  Cardiomyopathie : Cardiomyopathie :
Augmentation de volume du cœur dont les cavités sont plus larges et les parois plus minces que celles d'un cœur normal. La myocardiopathie dilatée évolue vers une insuffisance de la pompe cardiaque dans sa totalité (insuffisance cardiaque globale) dont le traitement est difficile voire impossible.  Canule Canule
Petit tuyau utilisé pour introduire un liquide ou un gaz dans une cavité.  Cathéter : Cathéter :
Fin tuyau souple destiné à être placé en permanence dans une veine pour réaliser des injections ou perfusions.  Cathétérisme Cathétérisme
Introduction d'un cathéter dans un canal ou un vaisseau dans un but diagnostique ou thérapeutique.  Cétonurie : Cétonurie :
Le terme cétonurie désigne la présence anormale de corps cétoniques dans les urines.  Charte : Charte :
Constitution accordée par un monarque, lois fondamentales qui définissent les devoirs et les droits des citoyens et du gouvernement.  Chirurgie orthopédique : Chirurgie orthopédique :
L'orthopédie est la discipline chirurgicale relative au traitement des lésions de l'appareil locomoteur. Elle inclut la traumatologie qui traite plus particulièrement les lésions traumatiques.  Chirurgie Vasculaire Chirurgie Vasculaire
Geste chirurgical réalisé au niveau des vaisseaux sanguins (dilatation des vaisseaux, ponctage, mise en place de stent).  Chlorhexidine : Chlorhexidine :
Ce médicament est un antiseptique local.
Il est utilisé pour l'antisepsie de la peau, notamment avant ou après un acte chirurgical.
 Cholestérol : Cholestérol :
Substance grasse (stérol) qui se trouve dans les cellules du sang et de la bile.  Cinétique : Cinétique :
 Coma chez un diabétique : Coma chez un diabétique :
Le coma est une des complications susceptibles de survenir chez un diabétique. Il peut également survenir pour des raisons indépendantes au diabète.
 Coma acido-cétosique : Coma acido-cétosique :
Le coma survenant à la suite d'une acidocétose par carence ou insuffisance d'apport en insuline médicamenteuse. Le diabète se caractérise par un manque ou une mauvaise utilisation de l'insuline dans le sang, secondaire à un déficit de fabrication de cette hormone par le pancréas. Cette maladie débute brutalement, et si elle n'est pas traitée, elle aboutit à une autre maladie appelée l'acidocétose.  Coma survenant par accumulation d'acide lactique : Coma survenant par accumulation d'acide lactique :
Ceci survient généralement quand le diabétique présente une infection grave ou un collapsus cardio-vasculaire (impossibilité pour les principaux organes de l'organisme d'assurer leur fonction circulatoire entre autres).  Coma hyperosmolaire : Coma hyperosmolaire :
Coma provoqué par une très forte hyperglycémie, mais qui ne s'accompagne pas de cétose (présence de sucre mais pas d'acétone dans les urines). Ce coma se voit surtout chez les diabétiques de type 2 à l'occastion d'une maladie aiguë comme une pneumonie qui favorise une décompensation du diabète.  Coma hypoglycémique : Coma hypoglycémique :
Le coma hypoglycémique est lié à une chute du taux de sucre dans le sang due à un excès d'insuline ou de médicament hypoglycémiants oraux. Il s' agit de médicaments utilisés chez le diabétique non insulinodépendant (nécessitant pas d'insuline pour équilibrer son diabète)  Comorbidité : Comorbidité :
Présence de plus d'une maladie ou autre affection chez une même personne à un même moment.  Compensatoire Compensatoire
Qui établit une compensation.  Complication : Complication :
Phénomènes morbides nouveaux apparaissant au cours d'une maladie.  Coordonnateur : Coordonnateur :
Personne responsable de l’administration d’un organisme, d’un projet, d’une activité ou d’une production.  Coronaire (artère) : Coronaire (artère) :
Artère irriguant le myocarde.
Le rétrécissement des coronaires provoque l'angine de poitrine, voire l'infarctus du myocarde.
 Coronarographie : Coronarographie :
Radiographie des artères coronaires injectées par du liquide opaque aux rayons X. La coronarographie est l’examen indispensable qui permet de confirmer le diagnostic d'angine de poitrine et de rechercher éventuellement une complication. Cet examen radiologique met en évidence les artères coronaires et fournit un bilan précis de leur état.  Coronaropathie : Coronaropathie :
La coronaropathie correspond à l'atteinte des coronaires. Le terme coronarien désigne tout ce qui se rapporte aux vaisseaux coronariens. En fait il est utilisé pour signaler le syndrome (ensemble de symptômes) d'insuffisance coronarienne c'est-à-dire l'insuffisance d'irrigation ou apport insuffisant de sang au myocarde (muscle du cœur). |
D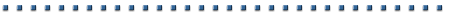
|  |  Débit de base : Débit de base :
Petite quantité en insuline diffusé de façon continu pendant 24h/24h et programmer dans la pompe.  Décollement de la rétine : Décollement de la rétine :
Le décollement de la rétine survient quand le corps vitré se replie sur lui-même, occasionnant du même coup une absence de pression et donc une désolidarisation de la rétine et de l'épithélium pigmentaire. A ce moment-là, l'humeur aqueuse contenue normalement dans le vitré passe derrière l'épithélium pigmentaire et décolle progressivement la rétine.  Dégénérative : Dégénérative :
Maladie évolutive où, d'une phase à l'autre, on note une augmentation des déficiences et des incapacités de la personne atteinte.  DCCT : DCCT :
Le DCCT (diabetes controls complications trial) est une étude multi-centrique incluant 1441 patients diabétiques de type 1 âgés de 13 à 39 ans sur 29 centres aux Etats Unis et au Canada.
L'Etude s'est déroulée sur 6,5 ans en moyenne de 1983 à 1993. Le but de l'étude était
de déterminer l'effet du contrôle glycémique autant sur le développement des complications chez les patients qui n'en a pas que sur la progression des complications chez les patients qui en ont déjà.  Diabète : Diabète :
Incapacité partielle de l'organisme à oxyder les hydrates de carbone ou les glucides.
Maladie se traduisant par l'émission d'urines abondantes et une soif intense.
 Diabète gestationnel : Diabète gestationnel :
Diabète survenant durant la grossesse, diabète qui ne contre-indique pas celle-ci. Le diabète sucré consiste en l'élimination du sucre de l'organisme dans les urines. On distingue deux types de diabètes :
- Diabète de type 1 : insulinodépendant (nécessitant de l'insuline pour diminuer le taux de sucre dans le sang) qui commence habituellement dans l'enfance ou chez l'adulte jeune. Celui-ci représente moins de 10 % des cas de diabète.
- Diabète de type 2 : non insulinodépendant, découvert le plus souvent à l'âge adulte. Celui-ci représente environ 90 % des cas de diabète mais reste généralement méconnu.
 Diabète insulinodépendant : Diabète insulinodépendant :
Le diabète insulinodépendant se caractérise par un déficit de la sécrétion d'insuline fabriquée par le pancréas. Il se traduit par une élévation anormale du taux de sucre dans le sang (glycémie) nécessitant des injections d'insuline pour être traitée, et survient souvent avant l'âge adulte, parfois juste après la naissance.  Diabète sucré : Diabète sucré :
Perturbation de la régulation des sucres de l'organisme par l'insuline.
Augmentation du glucose dans le sang et éventuellement sa présence dans les urines existe sous deux formes :
1) le diabète insulino-dépendant, qui nécessite des injections d'insuline,
2) le diabète non insulino-dépendant, soignable par des hypoglycémiants oraux.
Affection le plus souvent héréditaire, touche l'homme davantage que la femme.
 Dialyse : Dialyse :
Procédé thérapeutique temporaire ou définitif, permettant d’éliminer les toxines (urée, acide urique) et l’eau qui sont contenues en trop grande quantité dans le sang lorsque les reins ne sont plus en mesure d’assurer leur fonction de maintien de l’organisme dans un équilibre en eau, sodium, potassium et calcium aussi parfait que possible.  Dilatation : Dilatation :
Augmentation du volume d'un organe.  Diurétique : Diurétique :
Terme caractérisant de façon générale ce qui augmente la sécrétion urinaire. Le plus souvent le terme diurétique est utilisé pour désigner des médicaments dont le rôle est d'accroître la sécrétion rénale de l'eau et des électrolytes (sodium et chlore sous forme de sel de chlorure de sodium appelé vulgairement sel de table). On devrait donc parler plus exactement de salidiurétique plutôt que de diurétique tout court. L'action d'un salidiurétique est le suivant : par osmose le diurétique fait sortir du sel du sang vers les urines entraînant avec lui de l'eau et du plasma sanguin (partie liquide du sang).  Dosage de l'hémoglobine glyquée Dosage de l'hémoglobine glyquée
Examen de contrôle visant à mesurer la quantité de sucre fixée à l'hémoglobine ; ce test donne une indication de la glycémie moyenne sur plusieurs semaines (en cas d'élévation de la glycémie, le glucose se fixe sur l'hémoglobine, une substance contenue dans les globules rouges auxquelles elle donne leur couleur, et y subsiste durant toute la vie du globule rouge, soit 120 jours).
 Dysfonctionnement érectile Dysfonctionnement érectile
Trouble qui affecte le fonctionnement d'un organisme, d'un organe par suite d'un afflux de sang. |
G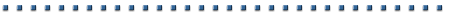
|  |  Glucagon : Glucagon :
Hormone sécrétée par le pancréas, permettant d'augmenter la glycémie (quantité de sucre dans le sang) et favorisant la lipolyse (destruction des corps gras).  Glucocorticoïde : Glucocorticoïde :
L'hypocorticisme désigne la diminution de la sécrétion des hormones synthétisées habituellement par le cortex des glandes surrénaliennes (partie périphérique) c'est-à-dire les minéralocorticoïdes, essentiellement l'aldostérone, les glucocorticoïdes (surtout le cortisol) et les androgènes (essentiellement la déhydro-isoandrostérone).  Glucose : Glucose :
Le glucose est la principale substance énergétique susceptible de faire défaut au cerveau. Une carence (absence) en glucose entraîne des perturbations et un fonctionnement anormal de cet organe, pouvant aller jusqu’à des lésions cellulaires et tissulaires, et même jusqu’à la mort quand la carence se prolonge dans le temps.  Glycémie : Glycémie :
Taux de glucose (sucre) dans le sang. Celui-ci varie en fonction de : - L’activité de l’individu
- Son alimentation
- Ses capacités hormonales
- Des capacités de l’insuline (l’hormone fabriquée par le pancréas, et dont le rôle est la régulation de cette glycémie).
Le taux normal de la glycémie est de 1 g par litre. Cette glycémie doit être sensiblement constante afin d’apporter aux organes et aux tissus des quantités de glucose sanguin relativement stables.
 Gradient porto-systémique : Gradient porto-systémique :
Taux de variation d'une grandeur physique, biochimique ou physiologique qui dépend d'un paramètre  Groupe intensif : Groupe intensif :
Groupe de patients traités de manière intensif avec un objectif en hémoglobine glyquée inférieure à 7%. |
H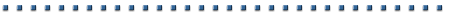
|  |  Hémoglobine : Hémoglobine :
Pigment de coloration rouge contenu par les globules rouges (hématies) permettant le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus.  Hémoglobine glyquée Hémoglobine glyquée
L'hémoglobine glyquée (ou glycosylée) est un paramètre permettant d'avoir un image de la glycémie pendant les 2 à 3 mois antérieurs à l'examen. Plus la glycémie est élevée et la durée de cette augmentation importante, plus la quantité de glucose attachée à l'hémoglobine dans le sang est grande et plus le pourcentage d'hémoglobine glyquée (ou glycosylée) est élevé.
 Hémorragie : Hémorragie :
Perte de sang à partir d'une artère ou d'une veine (interne/externe)  Holter : Holter :
Technique d'enregistrement de l'activité cardiaque d'un sujet pendant 24 ou 48 heures, lui permettant de continuer ses activités normalement, sans alitement ni hospitalisation.  Holter glycémique : Holter glycémique :
Technique d'enregistrement des glycémies (présence de glucose dans le sang)  Hormone : Hormone :
Substance transportée par le sang, destinée à réguler l'activité de certaines glandes ou de certains organes.  Hyperglycémie : Hyperglycémie :
Taux de sucre trop élevé dans le sang.  Hyperinsulinisme : Hyperinsulinisme :
Taux trop important d'insuline dans le sang. Ceci aboutit quelquefois à des convulsions avec hypoglycémie (chute du taux de sucre dans le sang) s'accompagnant de lipothymie, voire de syncope. Ce syndrome (ensemble de symptômes) est dû à une lésion du pancréas à l'origine d'une sécrétion trop important d'insuline (insulinome ou hyperplasie des îlots de Langerhans).
 Hyperkératose : Hyperkératose :
Ensemble de dermatoses (maladie de peau) se caractérisant par une hyperplasie (excès de fabrication) de la couche cornée (couche la plus superficielle de la peau) de l'épiderme.
Dans certains cas l'hyperkératose est le résultat d'un travail excessif de l'épiderme (comme cela survient chez les travailleurs manuels) entraînant l'apparition de callosités.  Hypoglycémiant : Hypoglycémiant :
Terme désignant tout ce qui diminue le taux de sucre dans le sang. Les médicaments antidiabétiques oraux (médicaments à avaler) nécessitent une surveillance étroite à cause de leurs effets indésirables qui sont quelquefois gravissimes.
 Hypoglycémie : Hypoglycémie :
Diminution de la quantité de glucose (sucre de façon générale) contenue dans le sang au-dessous de 0,5 grammes par litre (soit 2,8 millimolles par litre). |
I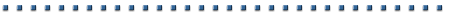
|  |  Iatrogène : Iatrogène :
Qui est provoqué par le médecin (ou par le traitement médical).  Ilot de Langerhans Ilot de Langerhans
Paul Langerhans était un chercheur allemand né à Berlin en 1847 et mort à Madère en 1888. Ce physiologiste a découvert les propriétés de certaines cellules du pancréas et en particulier celles composant les îlots auxquelles il a donné son nom : les îlots de Langerhans. Il s'agit de petits massifs constitués d'un regroupement de cellules au sein du pancréas et qui sécrètent l’insuline.  Immunosuppression : Immunosuppression :
Le terme immunodépresseur (ou immunosuppresseur) désigne tout ce qui supprime ou qui a la capacité de réduire les réactions immunologiques spécifiques de l'organisme contre un antigène (corps étranger pénétrant dans l'organisme).
 Infarctus : Infarctus :
Infiltration du tissu par un épanchement sanguin, notamment hémorragie à l'intérieur du myocarde.  Infiltration : Infiltration :
Accumulation anormale de liquide ou de cellules dans un tissu.  Insuffisance coronaire aiguë : Insuffisance coronaire aiguë :
Terme désignant la disposition de santé dans laquelle se trouve un patient qui risque, plus ou moins rapidement selon les individus, d'être confronté à l'oblitération d'une artère coronaire c'est-à-dire la diminution du passage sanguin dans une ou plusieurs artères irriguant le muscle cardiaque : le myocarde.
 Insuffisance coronarienne : Insuffisance coronarienne :
Le muscle cardiaque (myocarde) nécessite continuellement de l'oxygène qui lui est apporté par sa propre circulation sanguine, par l'intermédiaire des coronaires. L'insuffisance coronarienne se définit comme une diminution de l'arrivée du sang dans le myocarde (une irrigation imparfaite) susceptible de provoquer à la longue des lésions parfois graves du myocarde. On distingue l'insuffisance coronarienne organique généralement le résultat d'une lésion entraînant un rétrécissement du calibre des artères coronaires, le plus souvent l'athérosclérose et l'insuffisance coronaire fonctionnelle beaucoup plus rare, mais survenant à l'occasion d'une diminution de l'irrigation de ces coronaires.  Insuffisance rénale : Insuffisance rénale :
Diminution progressive rapide du pouvoir de filtration des reins (nécessaire à l’élimination des déchets du sang), associée à un déséquilibre de l’organisme en sel et en eau et à des difficultés de régularisation de la pression du sang (tension artérielle). Classiquement, on distingue l’insuffisance rénale aiguë de l’insuffisance rénale chronique. Globalement, une insuffisance rénale se caractérise par une diminution de la fonction et du nombre des néphrons (unités de base constituant le rein et servant à débarrasser le sang des toxines qu’il contient, en élaborant l’urine primitive).  Insuline : Insuline :
Hormone sécrétée par le pancréas. Elle est qualifiée d’hypoglycémiante parce qu’elle diminue le taux de glucose (sucre simple) dans le sang (glycémie). Son insuffisance de fabrication provoque le diabète. L’insuline est fabriquée par le pancréas au niveau des cellules appelées cellules bêta des îlots de Langerhans (pancréas). Elle est élaborée sous la forme de pro-insuline : il s’agit d’une forme d’insuline inactive uniquement utilisée pour le stockage. Cette pro-insuline va se diviser en deux parties selon les besoins de l’organisme : le peptide C et l’insuline. L’insuline proprement dite circule dans le sang, et va se fixer sur des récepteurs spécialisés et spécifiques situés à la périphérie des cellules (au niveau de leur membrane) dans le foie, les muscles, et le tissu adipeux (graisse).  Insulinopénie : Insulinopénie :
 Insulino-réquérant : Insulino-réquérant :
Diabète nécessitant en complément de son traitement par antidiabétiques oraux un traitement par insuline.  Insulinorésistance : Insulinorésistance :
Inefficacité de l'insuline néanmoins sécrétée normalement. Quelquefois la sécrétion se fait en grande quantité à partir du pancréas ce qui n'empêche pas cette hormone de ne pas assurer l'absorption normale du sucre (glucose) par les tissus de l'organisme ni la régulation de la fabrication du sucre par la glande hépatique (foie).
 Insulinothérapie : Insulinothérapie :
De nombreuses techniques de traitement sont utilisées, qui visent toutes à concilier confort et efficacité. Il n'existe pas de technique idéale pour tous les diabétiques mais une certaine technique pour un diabétique donné.
La répartition de l'insulinothérapie doit être étudiée pour respecter les besoins théoriques totaux, en fonction de l'activité physique, de l'alimentation, et du rythme de vie.  Ischémie : Ischémie :
Diminution de la vascularisation artérielle, donc de l'apport sanguin, au niveau d'une zone plus ou moins étendue d'un tissu ou d'un organe.  Ischémie maculaire : Ischémie maculaire :
Ischémie à l'intérieur de la macula (composant du globe occulaire).  Intra-vitréenne Intra-vitréenne
Lésions situées à l'intérieur du vitrée (composant de globe occulaire). |
J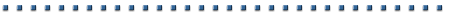
|
K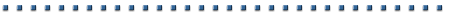
|
N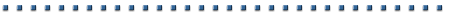
|  |  Néovaisseau : Néovaisseau :
nouveau canal servant à la circulation des liquides de l'organisme.  Néphropathie diabétique : Néphropathie diabétique :
Affection des reins chez le patient diabétique.  Neuralgie Neuralgie
Douleur du système nerveux.  Neuropathie : Neuropathie :
Atteinte des systèmes nerveux périphériques, plus rarement atteinte du système végétatif.  Neuropathie diabétique : Neuropathie diabétique :
Variété d'atteinte neurologique touchant les nerfs périphériques due à un dérèglement métabolique (du fonctionnement de l'organisme) apparaissant chez les diabétiques présentant depuis une longue période un déséquilibre glycémique à type d'hyperglycémie (excès de sucre dans le sang).
Les complications touchant le système nerveux se caractérisent essentiellement par :
- La polynévrite (inflammation des nerfs) touchant essentiellement les membres inférieurs. Elle se déclare par :
- des paresthésies (troubles de la sensibilité avec petite anesthésie, des fourmillements, des picotements)
- des dysesthésies (impression palpatoire anormale des choses), parfois douloureuses
- des réflexes sont modifiés
- une atteinte du système nerveux, génital et urinaire, mais également du tube digestif et du cœur, pouvant être à l’origine de l’augmentation de la mortalité.  Neuropathie hyperalgique : Neuropathie hyperalgique :
Maladie du système nerveux sensible à la douleur  Névralgie : Névralgie :
Cette douleur du visage survient essentiellement chez les personnes psychasthéniques. La psychasthénie se caractérise par une indécision de l'esprit associant une tendance aux doutes avec appréhension, le plus souvent sans raison. Les caractéristiques de la douleur sont les suivantes : localisation imprécise du territoire douloureux, douleur diffuse, continue, ressemblant à une brûlure. Le névralgisme facial s'accompagne de troubles vasomoteurs (perturbation de la fermeture et de l'ouverture des vaisseaux, le plus souvent des deux côtés = bilatéral).  Normoglycémie : Normoglycémie :
|
P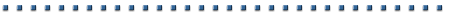
|  |  Pancréas artificiel Pancréas artificiel
Il est capable de délivrer de l’insuline (hormone permettant de faire baisser le taux de sucre dans le sang) sous la forme d’une pompe couplée à un détecteur de glucose sanguin fonctionnant de façon continue.  Paralysie flasque : Paralysie flasque :
Diminution ou privation d'un mouvement, impossibilité d'agir, de fonctionner  Paralysie amyotrophique : Paralysie amyotrophique :
Diminution ou privation d'un mouvement musculaire, notamment des muscles striés.  Paresthésie : Paresthésie :
Trouble de la sensibilité, désagréable et non douloureux, donnant l'impression de palper du coton, et pouvant s'accompagner d'une anesthésie (disparition plus ou moins importante de la sensibilité). Le terme généralement employé est fourmillement.  Perfusion intrapéritonéale : Perfusion intrapéritonéale :
Injection lente, prolongée et continue, à l'intérieur d'une veine (intraveineuse) le plus souvent, d'une quantité importante de sérum, de sang ou de substances médicamenteuses en solution (soluté).  Péritoine : Péritoine :
Membrane séreuse complexe qui recouvre la partie inférieure de la cavité abdominale. Chez l'homme, le péritoine ressemble en général à un sac fermé, alors que chez la femme, les trompes de Fallope pénétrent dans le péritoine. Le péritoine renferme la petite cavité au niveau de la partie supérieure de l'abdomen, près de l'estomac et du côlon transverse.  Pied artériopathique Pied artériopathique
Atteinte des vaisseaux des pieds (plaque d'athérome, thrombose).  Pharmacocinétique : Pharmacocinétique :
Etude du devenir des médicaments dans l'organisme.  Pharmacodynamique : Pharmacodynamique :
Relatif à l'activité des médicaments.  Pharmacovigilance : Pharmacovigilance :
Spécialité médicale dont le but est la surveillance des effets indésirables des médicaments. Avant sa mise sur le marché, l’action d’un médicament doit être observée scrupuleusement, c'est la pharmacovigilance.  Photocoagulation : Photocoagulation :
Mécanisme utilisant un rayon de lumière suffisamment puissant permettant de cicatriser que certaines lésions situées au niveau des muqueuses (ensemble de cellules recouvrant l'intérieur des organes en contact avec l'air) ou de l'épithélium (ensemble des cellules de recouvrement le corps en surface comme la peau) ou encore des lésions localisées dans l'appareil respiratoire (poumons), et au niveau de l'œil comme celles survenant dans la dégénérescence maculaire.  Physiologique : Physiologique :
Relatif au fonctionnement d'un organe, contrairement au psychologique.  Pied diabétique : Pied diabétique :
Le diabète insulinodépendant (nécessitant un traitement par insuline) est susceptible d’entraîner des complications graves et fréquentes, qui sont secondaires aux troubles vasculaires eux-mêmes liés à l’athérosclérose et au durcissement des grandes artères. Les petites artères peuvent occasionner une microangiopathie (maladie des artérioles et des capillaires) qui aboutit à une ischémie tissulaire (absence d’irrigation par le sang de certains tissus de l’organisme). L’hygiène des pieds joue un rôle de premier plan chez les diabétiques, sinon on peut craindre la survenue :
- D’ulcères de taille variable susceptibles de creuser en profondeur l’épaisseur de la jambe.
- De mal perforant plantaire constitué par une ulcération indolore qui peut entraîner une lésion pouvant atteindre l’os et nécessitant la suppression des points d’appui, et la pratique d’une désinfection locale avec utilisation d’antibiotiques par voie générale.
 Podologie : Podologie :
Etude du pied, des ses affections.  Podologue : Podologue :
Celui, celle qui est spécialisé(e) en podologie.  Polyurie : Polyurie :
Sécrétion d’urine en quantité abondante, entraînant un volume urinaire supérieur à 2500 ml par jour.  Post-prandial : Post-prandial :
 Prestataire : Prestataire :
Service qui offre des prestations, des besoins.  Pré-prandial Pré-prandial
 Psychotrope : Psychotrope :
Médicament possédant une propriété dont l’action se fait spécifiquement sur l’activité cérébrale.
On distingue classiquement :
- Les psycholeptiques : médicaments déprimant l’activité mentale psychoplégique.
Les psycho-analeptiques : médicaments possèdant la capacité d’exciter l’activité mentale. Les plus connus sont les amphétamines.
- Les psychodysleptiques : appelés également psycho pathogènes, ces médicaments possèdent la propriété d’entraîner des troubles mentaux comme une déviation du jugement etc.. C’est le cas par exemple du haschisch et des hallucinogènes psychédéliques et onirogènes en général. |
Q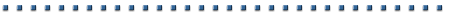
|
R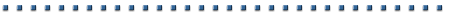
|  |  Référentiel : Référentiel :
Relatif à la référence (fonction d'un signe linguistique en tant qu'il désigne une chose).  Rénale : Rénale :
 Rétinopathie diabétique : Rétinopathie diabétique :
Affection de la rétine chez le patient diabétique.  Réseau : Réseau :
Réseau local, réseau de télécommunication généralement multiservice, établit sur un site restreint au sein d'un domaine privé connexe.  Rétine : Rétine :
La rétine est la membrane qui tapisse la face interne de l'œil et qui contient les cellules permettant aux rayons lumineux d’être captés puis transformés en influx nerveux pour gagner le cerveau. Cette membrane très mince et transparente est en contact par sa face arrière avec la choroïde. Ce contact se fait grâce à un tissu appelé épithélium pigmentaire.  Rétinopathie ischémique : Rétinopathie ischémique :
Maladie des yeux, de la rétine, de la membrane formée au fond de l'oeil par une expension du nerf optique et qui reçoit les impressions lumineuses.  Rétinopathie préproliférative : Rétinopathie préproliférative :
Maladie, affection de la rétine en état susceptible d'évoluer, de proliférer.  Rétroactive Rétroactive
Qui agit sur le passé, effet rétroactif |
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) : étude clinique prospective de 20 ans réalisée auprès de 5.000 patients atteints d'un diabète de type 2. L'étude UKPDS a débuté en 1977 et son objectif principal était de vérifier si un meilleur contrôle du diabète prévient
les complications au niveau des tissus et des vaisseaux. Les résultats de cette étude ont été rendus publics en 1998.
W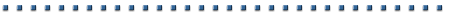
|
X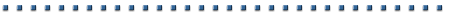
|
Y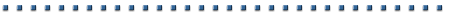
|
Z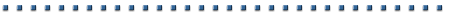
|
|
|
 |